Dans cet article, CAPE met en lumière les préoccupations et les revendications du secteur artisanal des Seychelles à la lumière des négociations en cours pour le nouveau protocole de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) entre l'UE et les Seychelles.
Temps de lecture : 10 minutes
La Commission européenne a reçu du Conseil le mandat de renégocier un protocole relatif à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) entre l'UE et les Seychelles, et les négociations commencent aujourd’hui.
Dans les directives de négociation, les États membres demandent à la Commission de garantir « une participation appropriée des parties prenantes à la programmation et à la mise en œuvre des activités » liées à l'APPD. Dans cette publication, nous souhaitons mettre en avant les préoccupations du secteur de la pêche artisanale à l’approche des négociations de l’APPD.
Le secteur de la pêche artisanale aux Seychelles se divise en deux grands groupes. Le premier regroupe les pêcheurs artisans opérant dans les zones côtières, utilisant des palangres, des pièges, des filets maillants, des sennes de plage et des harpons, et ciblant des espèces récifales telles que les vivaneaux, mérous, barracudas et poissons-perroquets. Leurs prises sont principalement vendues sur le marché local, notamment aux hôtels et restaurants. Le second groupe, plus restreint, est constitué de navires semi-industriels (14 à 23 mètres) qui, selon la saison, peuvent pêcher au-delà de la zone côtière en ciblant notamment le thon. Leurs captures sont en grande partie destinées à l’exportation.
1. Questions d’accès
a) Concurrence des navires industriels étrangers : faire face à la surcapacité dans l'océan Indien
Le protocole précédent de l’APPD autorisait l’accès de 40 thoniers senneurs et de 8 palangriers de surface, sur la base d’un tonnage de référence défini lors du dernier cycle de négociations. L’évaluation publiée en janvier 2025 a mis en évidence une utilisation réduite des autorisations de pêche dans la ZEE des Seychelles, en particulier depuis 2023. Elle souligne également que « les armateurs locaux ne subissent pas la concurrence de la flotte de l’UE » et qu’ils « soutiennent le renouvellement [de l’APPD] » (voir page 67 de l’évaluation). Parmi les APPD conclus par l’UE, celui des Seychelles compte en effet parmi les plus acceptés par les communautés locales.
Toutefois, si les pêcheurs artisans opérant dans la zone côtière sont relativement épargnés par la concurrence de la flotte de l’UE et d’autres flottes industrielles étrangères, la situation est différente pour les navires semi-industriels seychellois. « Nos navires semi-industriels sont immobilisés à Port Victoria depuis des mois », déclare Rodney Nicole, membre du conseil d’administration de la Seychelles Fisherman and Boat Owner Association (SFBOA), la plus grande organisation de pêche artisanale du pays. La flotte de l’UE n’est pas la seule présente dans la ZEE des Seychelles : le pays a signé plusieurs accords de pêche avec d’autres nations et a récemment conclu un protocole d’accord régularisant la présence de 15 palangriers chinois. Selon Rodney Nicole, la surcapacité dans l’océan Indien contraint désormais les navires, qui partaient auparavant en mer pour 10 jours, à y rester trois fois plus longtemps pour capturer le même volume de poissons : « Le temps passé à bord a également un impact sur la qualité du poisson lorsqu’il est débarqué ». Pour Nancy Ramkalawan-Onginjo, présidente de la SFBOA, cette situation s’explique par le fait que, depuis quelques années, « les espèces apparentées au thon ont complètement disparu du plateau de Mahé », car elles sont interceptées bien avant par les navires industriels de pêche au thon.
La question de la surcapacité dans l’océan Indien est un sujet sur lequel les représentant·e·s de la SFBOA alertent depuis longtemps, en particulier concernant la capacité des senneurs et l’impact des dispositifs de concentration de poissons (DCP). En 2017, ils ont d’ailleurs cosigné une position sur l’attribution des droits d’accès à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), appelant à des critères équitables réservant explicitement une part des ressources aux flottes artisanales et semi-industrielles des États côtiers. Cette question fait déjà l’objet de discussions au sein de certaines organisations régionales de gestion des pêches, comme la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique.
Propositions pour les négociations
> Sur la base d’une évaluation transparente et scientifique des besoins en matière d’accès pour la pêche semi-industrielle, l’UE et les Seychelles devraient veiller à garantir à la flotte semi-industrielle seychelloise un accès prioritaire aux ressources.
> L'UE devrait plaider, avec ses partenaires, auprès de la CTOI pour la mise en place d'une approche de l'attribution des droits d'accès qui privilégie les navires - qu'ils soient locaux, y compris les navires de pêche artisanale, ou étrangers) - qui pêchent d'une manière durable sur le plan environnemental et social et qui apportent le plus d'avantages aux États côtiers (emploi local, débarquements, etc.).
b) DCP : Pollueurs? Payeurs !
Depuis le dernier protocole, les senneurs de l’UE sont tenus de contribuer, via une redevance, à un fonds national pour l’environnement. Selon l’évaluation (page 19), 53 % de ce fonds ont été utilisés par l’Autorité des pêches des Seychelles (SFA) pour récupérer les DCP ainsi que d’autres équipements de pêche abandonnés. Malgré ce programme de récupération, des DCP continuent d’arriver sur le plateau de Mahé et d’être ramassés par les pêcheurs artisans dans les zones côtières.
Ces DCP peuvent endommager les engins de pêche, mais représentent aussi un danger pour la sécurité, notamment en cas de collision nocturne. Les pêcheurs réagissent de manière pragmatique : « certains sont même recyclés par nos communautés », souligne Nancy Ramkalawan-Onginjo. La SFBOA plaide toutefois pour des mesures plus strictes concernant les DCP dérivants abandonnés, jugeant le programme actuel de retrait trop coûteux. « Il faut appliquer le principe du pollueur-payeur », insiste Rodney Nicole. « Ces DCP sont équipés de systèmes d’identification ; il est donc facile de remonter à la source et de sanctionner le navire responsable. »
Proposition pour les négociations
> Introduire une clause contraignante de « pollueur-payeur » dans le protocole, obligeant les senneurs de l'UE à financer les coûts de récupération des DCP perdus, avec une traçabilité claire et des amendes lorsque les propriétaires sont identifiés.
c) L’objectif des débarquements : des retombées locales positives sans bouleverser l’activité des communautés de pêche
Dans leurs conclusions, les évaluateurs soulignent que l’APPD a effectivement généré des bénéfices pour le secteur local, car « les senneurs de l’UE ont vendu l’équivalent de 18 % de leurs captures dans l’océan Indien, y compris dans la zone de pêche des Seychelles, à la conserverie locale, ce qui a permis de transformer localement en moyenne près de 37 000 tonnes de thonidés par an » (page 56). Le reste des captures a été transbordé vers des navires frigorifiques en vue d’exportation. Selon l’évaluation, les activités liées à la conserverie locale génèrent environ 1 500 emplois.
L’évaluation précise également qu’une « proportion inconnue de prises accessoires » est « débarquée par des senneurs, y compris des senneurs de l’UE, qui ont trouvé un créneau commercial local pour les populations les plus pauvres des Seychelles ». Ce phénomène serait lié aux « prix relativement bas par rapport au poisson frais débarqué par les pêcheurs artisans locaux. » Ces derniers ont toutefois un point de vue différent, affirmant que certaines de ces captures entrent en concurrence avec leurs propres prises et perturbent le marché local. Les évaluateurs y voient surtout un problème de communication : « Ces points de vue suggèrent que la communication sur les interactions entre les flottes thonières de l’UE et les flottes artisanales devrait être améliorée. »
Dans les APPD africains, CAPE recommande généralement le débarquement local des prises accessoires afin de soutenir les femmes transformatrices de poisson, qui ont souvent un accès limité aux matières premières. Aux Seychelles, cependant, l’absence totale de données ventilées par genre dans le secteur de la pêche – un manque que reconnait le Ministère de l’économie bleue lui-même – empêche d’avoir une vision claire du secteur et des défis spécifiques au genre.
De plus, comme le signale l’évaluation, l’insuffisance de données sur les prises accessoires rend difficile l’évaluation de leur impact réel sur le marché local. Dans ce contexte, il est encourageant que « l’Autorité des pêches des Seychelles (SFA) soit en train de mettre au point un système de gestion des données approprié pour collecter ces informations », et CAPE encourage l’UE à soutenir cette initiative, ainsi que la collecte de données ventilées par genre sur le secteur de la pêche artisanale.
Propositions pour les négociations
> Mettre en place un mécanisme de suivi transparent des débarquements de prises accessoires, avec des données ventilées par espèce, volume et prix, afin d’évaluer leur impact potentiel sur les captures de la pêche artisanale.
> Conditionner l’obligation de débarquement des prises accessoires à deux critères : qu’elles ne provoquent pas une baisse des prix pour les pêcheurs artisans et qu’elles garantissent un accès équitable aux femmes transformatrices de poisson. Pour atteindre ces objectifs, le soutien de l’UE devrait inclure une assistance technique et financière afin d’améliorer la collecte de données, notamment celles ventilées par genre.
2. Appui sectoriel
a) Transparence et participation autour de l’allocation de l’appui sectoriel
Les communautés de pêche artisanale demandent à être consultées dans le cadre du processus d’évaluation et de la définition des priorités pour l’utilisation des fonds de l'appui sectoriel. Elles reconnaissent toutefois les efforts réalisés pour mieux faire connaître les projets financés par les fonds de l'appui sectoriel de l’UE dans le cadre de l’APPD, notamment grâce à l’apposition du drapeau de l’UE sur ces projets.
La SFA a également amélioré sa communication sur l’utilisation des fonds et, plus largement, sur le processus de l’APPD. L’évaluation fournit d’ailleurs un bon aperçu des projets financés. Néanmoins, CAPE et la SFBOA réitèrent leur demande de publication du rapport sur l’utilisation de l’appui sectoriel, afin de permettre aux parties prenantes de participer au dialogue en toute connaissance de cause.
Propositions pour les négociations
> L’UE devrait publier les rapports annuels détaillant l’utilisation des fonds de l'appui sectoriel, et demander que les organisations de pêche artisanale soient consultées avant toute décision concernant l’allocation de ces fonds.
> L’UE devrait également s’assurer que toutes les organisations de pêche soient systématiquement consultées dans le cadre du processus d’évaluation. Lors de la dernière évaluation de janvier 2025, la principale organisation de pêche artisanale, la SFBOA, n’a pas été associée.
b) Soutien au secteur local : personne ne doit être laissé de côté
La SFBOA se déclare globalement satisfaite des fonds alloués en soutien au secteur de la pêche artisanale. Parmi les projets mentionnés dans l’évaluation figurent la modernisation de plusieurs sites de débarquement sur les îles de Mahé, Praslin et La Digue. Cependant, l’évaluation ne fournit aucune information sur la fréquentation de ces sites, n’ayant pas consulté les associations locales de pêche. La SFBOA souligne également certains aspects positifs tels que la construction de sites de commercialisation, notamment des dépôts d’équipement, la construction d’un quai pour l’académie maritime, ainsi que la mise en place d’une usine de glace. Les organisations locales de pêche artisanale ont par ailleurs bénéficié d’un soutien pour leur enregistrement officiel ou pour le financement de leurs secrétariats à hauteur de 1 000 € par mois (page 43 de l’évaluation).
Pour le prochain protocole, la SFBOA demande le maintien du soutien financier aux associations de pêcheurs, ainsi que la poursuite du financement des infrastructures, y compris « l'entretien et à la maintenance des installations existantes ». L’Organisation exprime également le besoin de davantage d’usines de glace, « en particulier pendant la haute saison [NDLR : quand le temps est clément], car la concurrence pour la glace est forte en raison de la production des navires semi-industriels », explique Rodney Nicole.
Enfin, la SFBOA se réjouit de la création, en avril dernier, d’un fonds de pension pour les pêcheurs : « Les pêcheurs enregistrés âgés de 55 ans maximum cotisent pendant au moins 10 ans à hauteur de 50 % du montant, le reste étant complété par l'appui sectoriel », précise Rodney Nicole. Mais il regrette que « beaucoup de nos pêcheurs étaient intéressés, mais ont été disqualifiés en raison de leur âge », car de nombreux pêcheurs ont entre 58 et 60 ans et ne sont donc pas éligibles au fonds. M. Nicole indique que la SFBOA a tenté de négocier pour permettre aux personnes âgées de 58 ans maximum de bénéficier de trois ans de rétro-paiement, mais cette proposition n’a malheureusement pas été retenue.
Alors que la SFBOA œuvre au renouvellement générationnel de son secteur en encourageant les femmes et les jeunes à s’impliquer, elle demande également un soutien pour les pêcheurs en fin de carrière qui risquent une retraite précaire. « Nous demandons également que toutes les mesures soient mises en place », explique Rodney Nicole, afin que ce soient les véritables pêcheurs qui bénéficient de ce fonds. Il ajoute : « Aux Seychelles, n'importe qui peut s'inscrire comme pêcheur, à condition de payer une redevance. »
Propositions pour les négociations
> Veiller à ce que l’appui sectoriel couvre non seulement la construction, mais aussi l’entretien des installations, en donnant la priorité au financement des usines de glace.
> L’UE devrait poursuivre son soutien au renforcement des capacités des associations (formation, subventions administratives).
> Réviser les conditions d’éligibilité pour permettre aux pêcheurs plus âgés (par exemple jusqu’à 60 ans) de s’inscrire via des mécanismes de rétro-paiement, tout en renforçant les contrôles pour garantir que seuls les véritables pêcheurs soient inscrits. Le soutien de l’UE devrait également inclure des mécanismes de retraite alternatifs pour ceux déjà trop âgés pour être éligibles.
Conclusion
Le prochain APPD entre l’UE et les Seychelles ne sera légitime que s’il renforce, plutôt qu’il n’affaiblisse, la résilience des flottes artisanales et semi-industrielles seychelloises.
Cela implique des règles claires garantissant un accès prioritaire aux navires locaux, des obligations contraignantes pour les senneurs de l’UE de récupérer leurs DCP, et des mécanismes transparents veillant à ce que les débarquements de prises accessoires ne perturbent pas les marchés locaux, mais soutiennent au contraire les femmes transformatrices et les consommateurs à faibles revenus.
Le protocole doit également prévoir un appui sectoriel allant au-delà des seules infrastructures, couvrant la maintenance, l’administration et la protection sociale — des usines de glace aux systèmes de retraite — de manière réellement accessible à celles et ceux qui vivent de la pêche.
Ce protocole a le potentiel de devenir un modèle d’équité et de responsabilité dans la politique extérieure de l’UE en matière de pêche. Pour y parvenir, les négociateurs de l’APPD doivent placer la voix des communautés de pêche artisanale seychelloise et de leurs organisations au cœur du processus décisionnel.
Photo de l’entête : Un marché au poisson à Victoria, Seychelles, de Nenad Radojčić.







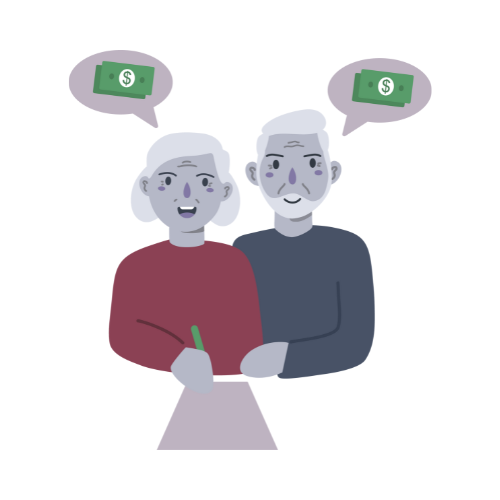





Au Seychelles, la population vieillissante des travailleurs de la pêche artisanale s'efforce d'assurer le renouvellement générationnel dans le secteur de la pêche en sensibilisant les écoliers à ce métier et en formant les jeunes femmes à se reconvertir dans le commerce du poisson.